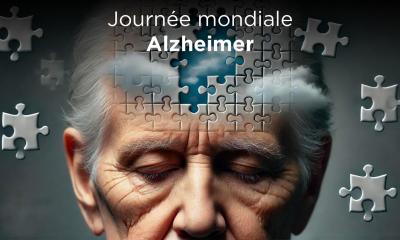Une tribune du Professeur Dreyfus, administrateur de la Fondation Cuomo, publiée dans Le Point
28 Mar 2025
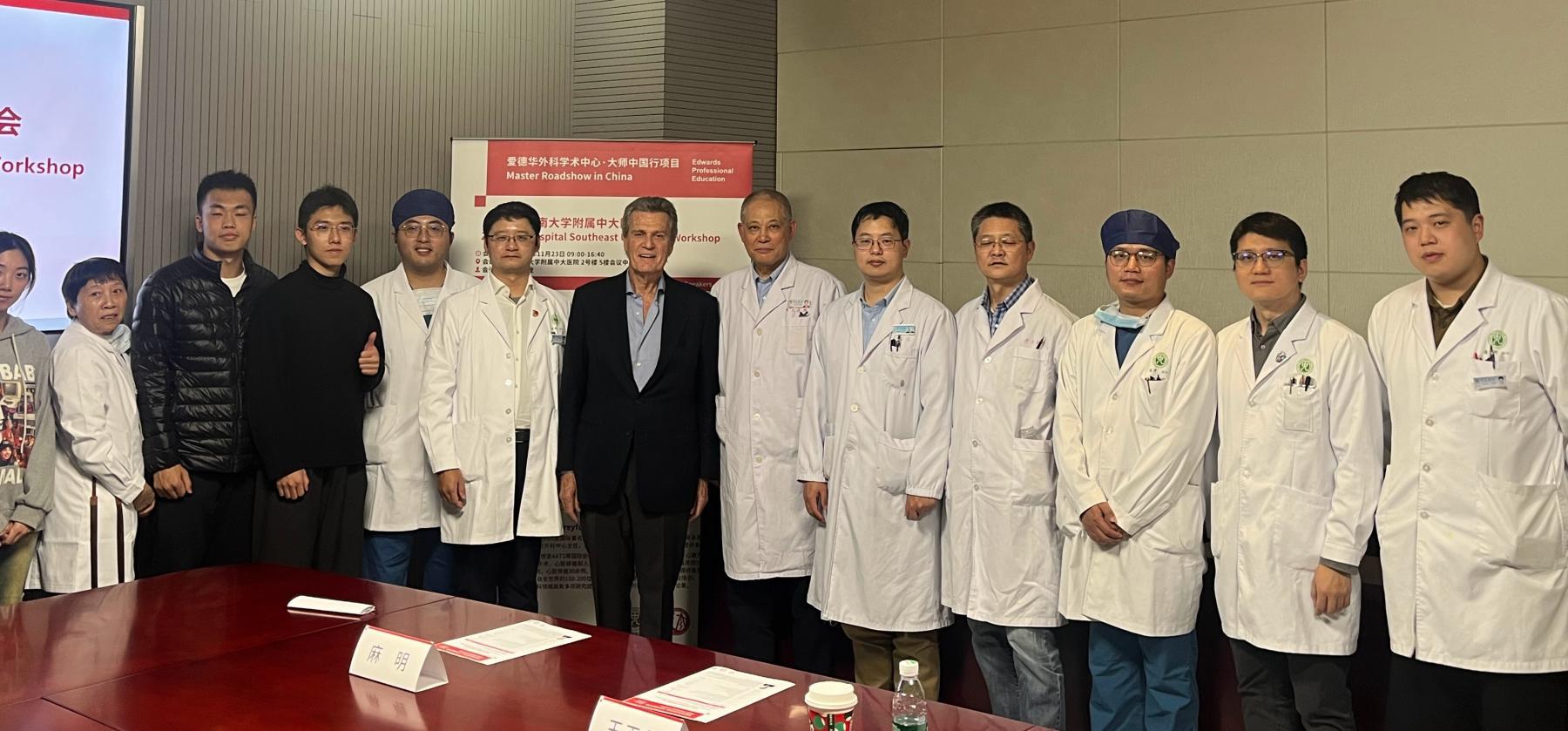
TRIBUNE. Le professeur Gilles Dreyfus dresse un état des lieux international parfois surprenant de sa spécialité et milite pour plus de transparence sur les résultats des équipes médicales.
LE POINT > Publié le 11/03/2025
Très tôt durant ma formation à l'hôpital Broussais à Paris sous l'autorité du Pr Alain Carpentier, j'ai été confronté au monde, puisque le monde entier venait y apprendre la chirurgie de réparation de la valve mitrale. D'éminents spécialistes des États-Unis, du Japon, du Brésil et de toute l'Europe étaient présents. J'ai donc vite compris qu'il fallait aller partout, apprendre, échanger, former, pour devenir meilleur. J'ai aussi compris que, de permettre à des pays en cours de développement d'acquérir des techniques innovantes faisait partie intégrante de ce métier.
Il fallait donc être à Paris, mais se comparer aux meilleurs aux États-Unis et en même temps consacrer du temps à ceux qui étaient demandeurs, comme à Ho Chi Minh Ville au Vietnam, au Cambodge, à Maputo au Mozambique, à Dakar au Sénégal…
A ÉCOUTER
RivieraRadio | Interview of Professor Gilles Dreyfus - 28.03.2025
L'Europe vieillit
Le monde de la médecine et de la chirurgie est un monde ouvert dans lequel la connaissance se répand comme une traînée de poudre, pour le bien des malades. Il y a naturellement des centres mieux équipés que d'autres, il y a des médecins qui ont plus d'expérience que d'autres, mais partout il existe des bons et des moins bons.
C'est un luxe inouï de se rendre aux États-Unis, plusieurs fois par an, et de débattre des résultats d'une technique ou d'une autre présentés dans les prestigieuses sociétés américaines, ou bien de discuter et même de revoir des études scientifiques de haut niveau dont les résultats sont publiés.
En résumé, c'est le travail de la recherche clinique qui permet de déterminer sur des données si tel ou tel traitement est meilleur qu'un autre. Et en même temps d'opérer en Chine ou en Inde, deux pays, deux « continents » surpeuplés et pour lesquels la médecine, comme le reste, avance à une vitesse incroyable. Et puis l'Europe, qui fut un temps un modèle, mais qui vieillit sans peut-être s'en rendre vraiment compte.
Discipline relativement récente
La médecine ne touche pas seulement la maladie, mais elle fait partie intégrante de la société avec le problème de son coût, de l'accès aux soins, de ses systèmes de protection sociale, et des équipements de plus en plus efficaces mais aussi de plus en plus coûteux. Je vois tout cela de façon pratique dans une spécialité très technique : la chirurgie cardiaque.
Cette discipline relativement récente est déjà battue en brèche par la cardiologie interventionnelle, qui a le vent en poupe, soutenue à la fois par le désir des malades de ne pas subir une opération à cœur ouvert et par l'industrie, qui, avec des instruments et des procédés ingénieux, voit ses bénéfices croître de façon gigantesque.
La chirurgie cardiaque est une spécialité où interagissent beaucoup de disciplines médicales en dehors de l'acte opératoire proprement dit, avec l'anesthésie et la réanimation, la bactériologie, la coagulation, l'imagerie médicale et, donc, représente une discipline qui est un bon marqueur de l'évolution médicale.
Aux États-Unis, deux médecines
Les États-Unis restent, et probablement pour longtemps, un modèle avec, cependant, des disparités qui ne doivent pas être sous-estimées. La force de l'Amérique réside dans sa culture des résultats, dans les études randomisées, dans la transparence.
Cependant, ce n'est pas l'Eldorado que beaucoup pensent. Il y a quelques centres de référence connus dans le monde entier ; Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Mount Sinaï à New York, Houston au Texas, Cedar Sinaï à Los Angeles et une dizaine d'autres.
Ce sont des centres d'excellence, traitant un gros volume de malades, avec des médecins hyperspécialisés, publiant leurs résultats accessibles à tous, ainsi que de grandes séries de malades avec un recul à dix ans, voire à quinze ou vingt ans. Ces centres coûtent cher, très cher, et ne sont pas accessibles à tous.
Parallèlement, il y a un système dit public ; financé par Medicare ou Medicaid, ou la Veteran Administration avec moins de volume, moins d'experts, remboursés par une prise en charge publique. Le niveau de la dépense publique pour la santé aux États-Unis est très élevé puisqu'il atteint plus de 18 % du PIB pour un système de santé loin d'être le meilleur.
Il existe donc deux médecines, auxquelles on accède, selon son niveau d'assurance privée complémentaire. Le coût de la santé ne faisant que croître, certaines assurances peuvent même refuser certains malades, car jugés trop graves ou trop coûteux.
Mais l'Amérique est un pays où la liberté de choix individuel prime sur tout. Vous pouvez choisir de ne pas être assuré, c'est votre choix, votre responsabilité. Une politique inacceptable et incompréhensible en Europe. Aux États-Unis, il n'y a pas d'État, il y a une fédération d'États libres et indépendants. Ce sont là des faits, en aucune manière une critique ou un exemple. Il n'en reste pas moins vrai que, ce qui n'est pas validé aux États-Unis est rarement validé dans le reste du monde.
La Chine pourrait bientôt surprendre le monde
Basculons rapidement vers l'est, qui semble, dans beaucoup de domaines, devenu l'épicentre du monde. Deux pays, « deux continents », la Chine et l'Inde avec plus de 3 milliards d'êtres humains. Ce qui frappe dans ce nouveau monde se résume à deux choses.
La première est la rapidité avec laquelle ils sont sortis des temps reculés et avec laquelle ils ont adopté les technologies et même en sont devenus à l'origine parfois. La deuxième porte sur les contrastes entre une classe moyenne qui gagne sa vie, se déplace, consomme et une part, encore importante, de la population vivant sous le seuil de pauvreté.
Il est impossible d'aborder ces deux monstres avec nos idées, nos concepts, notre frilosité et, je dirais, notre certitude surannée, que nous sommes les seuls à détenir la vérité. La Chine, celle que je connais, est ce pays qui va de Beijing à Shenzhen du nord au sud, et de Shanghai à Chengdu d'est en ouest. La médecine que j'y ai vue, en y allant une dizaine de fois pour opérer dans de nombreux grands centres, est remarquable.
Dans la plupart des hôpitaux de ma spécialité, la chirurgie cardiaque traite des volumes de malades inimaginables en Occident. À Beijing, les hôpitaux Fuwaî et Anzhen opèrent respectivement 16 000 et 15 000 malades à cœur ouvert par an. Opérer 16 000 malades par an revient à opérer dans une semaine de cinq jours soixante malades par jour. La gigantesque machine des consultations : plus de mille malades par jour, et celle du nombre de salles d'opération, du nombre de lits de réanimation et du personnel nécessaire est à peine imaginable.
Des mégacentres qui traitent jusqu'à dix mille patients par an
Les salles d'opération sont équipées, les réanimations ont tous les moyens modernes à leur disposition : appareils ventilatoires, seringues électriques, équipement d'assistance circulatoire et d'hémofiltration en cas d'insuffisance rénale.
Un tel volume est difficile à concevoir dans le monde dit occidental, même aux États-Unis, où les plus gros centres avoisinent les quatre mille malades par an, ou encore en Europe avec tout juste deux mille malades par an.
Il est difficile d'imaginer la charge de travail préparatoire, l'organisation, la disponibilité en infirmières formées, en médecins, en laboratoires d'analyses, en centre de transfusion. Il faut des réanimations gigantesques, de plus de cent lits, pour absorber une telle activité, et ce toute l'année.
Même si le coût du travail est bien plus bas, ces mégacentres, qui traitent entre cinq et dix mille patients par an, sont nombreux et partout on y sent l'influence du modèle américain. Mais ce qui frappe le plus est leur désir d'échanger, d'apprendre, de se confronter. Leur capacité à parler l'anglais et, donc, à lire les publications et à se tenir informés des progrès les plus récents est remarquable. Le travail, l'éducation, la connaissance sont le credo de cette nation en pleine mutation.
Il manque peut-être, en médecine, la transparence des résultats, la publication des résultats, mais qui peut leur en faire grief car l'Europe est aussi malade de ce point de vue. Compte tenu de ses volumes d'activité, la médecine chinoise pourrait bientôt surprendre le monde en publiant ses résultats, et, ainsi, comme les États-Unis, valider ou non une thérapeutique par rapport à une autre. Un monde fascinant en constante évolution.
En Inde, le même professionnalisme que partout ailleurs
L'Inde, un autre « continent », un autre pays, une autre approche. Les points communs, une population de 1,6 milliard d'habitants avec un développement explosif, peut-être encore plus que celui de la Chine. En Chine, 400 millions d'habitants constituent la classe moyenne, qui consomme, voyage et qui crée un marché intérieur.
En Inde, il y a 7 millions de personnes qui font marcher le pays, une classe moyenne qui est loin des standards européens avec un revenu moyen de 500 euros par mois, et 600 millions de gens sous le seuil de pauvreté. La tâche semble tellement immense qu'on se demande comment ce pays fonctionne. La chaleur, la promiscuité, la foule intense, la végétation luxuriante, les odeurs vous prennent à la gorge et puis la magie opère. C'est un monde à part.
Et pourtant, il fonctionne avec l'une des plus grandes croissances au monde, avec des technologies de pointe comme l'informatique, la pharmacopée et une médecine de qualité. J'ai moins parcouru l'Inde que la Chine mais j'y ai retrouvé des constantes ; des gens compétents à tous les niveaux, désireux d'échanger, d'apprendre, de comparer.
L'avantage des Indiens est que l'anglais est leur deuxième langue. Cela les rapproche du reste du monde et leur permet de communiquer. J'y ai retrouvé des volumes de malades au-delà de la norme à Bangalore dans deux unités différentes : l'une publique, l'autre privée, plus de cinq mille opérations à cœur ouvert par an et toutes les infrastructures et la logistique que de tels volumes imposent et qui est similaire de par le monde.
Dès que l'on est en salle d'opération, on y retrouve le même professionnalisme que partout ailleurs, la même rigueur, les mêmes réflexes. Malgré les difficultés, il existe, en Chine comme en Inde, des robots pour opérer le cœur (2,2 millions d'euros l'unité) et la tendance à la chirurgie mini-invasive est très populaire.
Il existe là-bas un débat que nous retrouvons en Occident surtout pour ce qui concerne la valve mitrale : vaut-il mieux être opéré pour avoir une réparation de la valve mitrale ou bien est-il préférable de poser un clip sur la valve mitrale sans être opéré ? Le contraste d'un tel débat dans un pays encore en développement et saisissant, il embrasse à la fois des techniques chirurgicales établies et une médecine en cours d'évaluation.
Les malades participent au coût
En effet, si la santé n'a pas de prix, elle a un coût. Que ce soit en Chine ou en Inde, les malades participent à ce coût. En Chine, il existe un plan de soins qui comprend trois niveaux d'assurance. Le niveau 1 est un système national accessible à tous les citoyens de la République de Chine, couvrant 87 euros par an pour les plus de 70 ans, 109 euros par an de 60 à 69 ans, 132 euros par an de 18 à 59 ans et 47 euros par an pour les moins de 18 ans.
Les consultations ne sont pas remboursées. Dans le cadre d'une chirurgie cardiaque avec remplacement valvulaire, le remboursement se fait à la sortie du malade, atteignant environ 65 % du coût. Le niveau 2 concerne les employés des grandes compagnies et de l'administration, l'employeur paie moins de 10 % de la couverture et l'employé en paie 2 %.
Un tiers de l'argent est envoyé sur le compte du citoyen pour ses dépenses médicales et deux tiers vont sur un compte national et en cas de remplacement valvulaire. Le patient est remboursé d'environ 80 % par le plan national.
Le niveau 3 concerne les compagnies commerciales qui participent au plan de santé national et qui assurent en général des niveaux de couverture élevés. Il existe donc une part qui incombe à chaque citoyen quel que soit le niveau.
En Inde, une « Modi Card »
En Inde, il existe un système qui rend l'accès aux soins gratuit pour tous, mais chaque malade doit participer au type de prothèse qu'il reçoit. Il y a, à côté de cette assurance sociale, des assurances privées qui permettent d'accéder à tous les soins et de ne pas payer les prothèses.
Plus récemment, il a été créé une « Modi Card », du nom du Premier ministre indien, pour faciliter l'accès aux soins des gens sous le seuil de pauvreté qui est payé par l'État. Cette « Modi Card » finance jusqu'à 1 lakh, c'est-à-dire 1 100 euros environ et peut même monter jusqu'à 3 lahks, soit environ 3 300 euros pour un malade.
On voit bien que ces États gigantesques tentent, malgré une proportion importante de la population sous le seuil de pauvreté, de combler ce manque pour ne laisser personne sans soin. Malgré tout, la participation du malade reste un élément fondamental lorsque celui-ci le peut. L'État ne peut pas tout.
Il sera intéressant de voir si les systèmes imparfaits tendent à se diriger vers nos systèmes européens qui sont, on se doit de le reconnaître, à bout de souffle, comme en France, en Italie ou en Grande-Bretagne.
Le palmarès des hôpitaux du Point pallie le manque de transparence
L'Europe tire encore bénéfice de ses avancées passées, mais le système souffre de maux sans solutions, sauf à changer de système. Des coûts de plus en plus importants, des masses salariales qui représentent 70 % du budget des hôpitaux, des carrières peu attractives, un manque criant d'infirmières surchargées de travail et mal payées avec des écoles d'infirmières qui cherchent des élèves ! S'ajoute à cela un vieillissement de la population et un ratio de cotisants-bénéficiaires qui ne fait que baisser pour des assurés plus vieux, plus malades.
Enfin, il reste un mal endémique, la transparence et la publication des résultats. Le magazine Le Point tente d'y pallier avec son palmarès des hôpitaux basé sur des données extrapolées du PMSI (programme de médicalisation des systèmes d'Information), un système comptable et non académique, qui ne recense pas le taux de mortalité, les infections et les réopérations, parfois nécessaires. Si on ne connaît pas les résultats immédiats, qu'en est-il des résultats à moyen et long terme ?
La cardiologie interventionnelle bénéficie d'un soutien massif de l'Industrie des médicaments et des prothèses, et cette même Industrie finance des études prospectives randomisées, qui leur sont, à quelques exceptions près, toujours favorables.
Il existe très peu de registres nationaux tels que celui de la Society of Thoracic Surgeons (STS Database), aux États-Unis, qui collige, année après année, tous les résultats de chacun. La sanction pour ne pas y participer est de ne pas être remboursé par le système. C'est sûrement une voie à explorer. La création de centres d'excellence aux États-Unis est aussi un exemple à suivre. Ces centres sont définis par leur volume et leurs résultats publiés par des hyperspécialistes. Nous en sommes bien loin.
Un médecin ou un chirurgien ne peut plus tout faire comme avant. Dans une spécialité comme la chirurgie cardiaque, il faut choisir sa voie : spécialiste des pontages coronariens, spécialiste de la chirurgie aortique, spécialiste de l'insuffisance mitrale ou spécialiste de l'insuffisance cardiaque. C'est la seule façon d'accéder à l'excellence.
À Dakar, le seul centre autonome de l'Afrique de l'Ouest
Enfin, il y a l'Afrique subsaharienne, où nous avons, avec l'aide de La Chaîne de l'espoir et un financement d'une fondation privée, construit le seul centre autonome de l'Afrique de l'Ouest, à Dakar, au Sénégal. Si l'approvisionnement de l'Inde et de la Chine ne pose aucun problème étant donné les volumes de malades traités, et le développement de leur propre matériel, il demeure un vrai problème pour l'Afrique. De même, la maintenance de tous les équipements électroniques et de mesures biologiques est elle aussi défaillante.
L'Afrique doit encore atteindre un volume critique pour intégrer ce monde technologique qui ne fait de cadeau à personne. Les missions dites humanitaires sont de plus en plus difficiles du fait des tensions géopolitiques, et sauver dix enfants lors de missions humanitaires est utile mais n'empêche pas plusieurs centaines d'autres de mourir faute d'accès aux soins.
La solution est de créer des centres autonomes avec des médecins africains. Mais le financement des coûts médicaux reste un problème surtout pour l'accès aux soins des plus défavorisé et là encore, peut-être plus qu'ailleurs le malade doit payer, s'il le peut !
Revaloriser les salaires des hôpitaux publics
Voilà mon expérience, mes visions de ce monde en pleine mutation où les États-Unis restent dominants, la Chine et l'Inde émergent à grande vitesse et l'Europe, dont la médecine reste de qualité – ce dont témoignent les grands congrès de cardiologie et de chirurgie européens qui figurent parmi les plus importants au monde –, mais se débat du fait des coûts sans cesse croissants et d'un modèle de financement qui atteint ses limites. L'Europe reste cependant menacée par son adaptation lente et imparfaite – et surtout, par le refus de faire des choix.
Il faut rationaliser les coûts, donc éviter de multiplier les centres. Cette politique a déjà été appliquée pour les maternités selon leur niveau d'activité et leur environnement d'autres spécialités pointues. Il faut connaître les résultats de chacun et financer en priorité les centres d'excellence, tout en limitant les centres de plus faible niveau d'activité.
Il a été démontré une corrélation entre le volume d'une pathologie donnée et les résultats. Il faut revaloriser les salaires des hôpitaux publics tant pour les médecins que pour les infirmières, pour éviter l'hémorragie des personnels vers le secteur privé, capable de les payer mieux, voire beaucoup mieux.
Chaque ville ne peut avoir toutes les spécialités, et donc il faut créer des centres primaires de diagnostic et de traitement pour les pathologies simples, puis des centres secondaires plus équipés avec des spécialistes plus adaptés et quelques centres dits « tertiaires » pour traiter les pathologies lourdes et complexes, comme cela existe déjà dans de nombreux pays. À défaut d'une refonte importante de notre système, les malades, comme les médecins, souffriront et ressentiront que le service rendu n'est plus à la hauteur de leurs attentes.
*Le professeur Gilles Dreyfus est chirurgien cardiaque à l'hôpital européen Georges-Pompidou à Paris, membre de La Chaîne de l'espoir, ancien chef de service à l'hôpital Foch et professeur à Londres à l'Imperial College.


 English
English![[MONACO-MATIN] Chirurgie cardiaque : le Pr. Gilles Dreyfus distingué](https://cuomo.foundation/images/data/image/article/237/custom_cover_237-400-240-c.jpg)